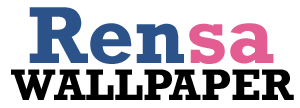Les critères géographique et empreinte environnementale dans la passation des marchés publics
Les entreprises qui les accompagnent avec sérieux et anticipation y trouveront un terrain favorable à leur développement. Ainsi, un marché de fournitures informatiques peut prévoir 50 % de la note sur le prix, 30 % sur la performance énergétique des équipements, et 20 % sur les engagements en matière de recyclage ou de reprise des anciens matériels. Cette répartition doit être cohérente avec l’objet du marché et le niveau d’ambition écologique défini en amont. Les acheteurs ne se contentent plus de répondre passivement aux besoins exprimés, mais questionnent ces besoins à l’aune des impératifs environnementaux.
- Le marché public est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
- Le code de la commande publique impose l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable lors de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante.
- Par ailleurs, l’opérateur tend à encourager une consommation responsable, notamment en facturant la consommation au Go.
- Les CCAG révisés en 2021 prévoient l’intégration d’une clause environnementale générale dans les marchés qui y sont soumis.
Depuis l’adoption de la loi Pacte et la modification du Code civil en 2019, toutes les entreprises Françaises doivent désormais tenir compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leur croissance économique. L’objectif du gouvernement est que les sociétés aient un impact positif sur l’environnement et sur la société en général, tout en restant économiquement viable. Face aux évolutions des normes environnementales et des comportements des consommateurs, décrocher une certification ou reconnaissance RSE est dorénavant un réel argument de vente. L’attribution des contrats de concession obéit à la même logique alors que les autorités concédantes sont invitées à tenir compte des critères environnementaux pour sélectionner la meilleure offre au regard de l’avantage économique global 2. Enfin, plus généralement, l’adoption d’un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) est désormais obligatoire pour les acheteurs réalisant des achats de plus de 50 millions d’euros HT par an 10. Publié tous les deux ans, le SPASER doit décrire les objectifs poursuivis dans le domaine des achats responsables, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de suivi 11.
De nombreuses infrastructures critiques déploient désormais une empreinte transfrontalière (réseaux électriques interconnectés, gazoducs internationaux, câbles sous-marins de télécommunication). La Cour internationale de Justice a rappelé dans l’affaire des «Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay » (2010) l’obligation de coopération environnementale transfrontalière, mais les mécanismes concrets de responsabilité partagée restent insuffisamment développés. Le Pacte mondial pour l’environnement, bien que non abouti, témoigne de cette recherche d’un cadre global cohérent. La responsabilité civile environnementale a connu un développement significatif avec l’introduction dans le Code civil du préjudice écologique par la loi Biodiversité de 2016. L’article 1246 dispose ainsi que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Cette responsabilité sans faute peut être engagée par les associations de protection de l’environnement, les collectivités territoriales ou l’État.
En droit français, le Code de l’environnement constitue le socle normatif principal avec ses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au régime de l’eau, à l’évaluation environnementale ou encore à la prévention des risques technologiques. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et la loi Énergie-Climat de 2019 ont renforcé les obligations des opérateurs énergétiques en matière de décarbonation. Plus récemment, la loi Climat et Résilience de 2021 a introduit de nouvelles contraintes, notamment en matière d’adaptation au changement climatique. Par exemple, une entreprise spécialisée dans le secteur de la construction pourrait se démarquer en proposant des matériaux éco-conçus ou des techniques de construction réduisant l’empreinte carbone.
Qu’est-ce qu’une considération environnementale ?
Le Conseil d’État a également souligné que ces nouvelles dispositions ne dérogent pas à l’exigence de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et que les critères d’attribution doivent rester objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (CE, 4 févr. 2021, avis, n° ). Ainsi, le critère vert est intégré dans le cadre plus large des critères d’attribution des marchés publics, qui peuvent inclure des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, en plus du prix ou du coût. Les critères d’attribution des marchés publics en France sont définis par plusieurs dispositions du Code de la commande publique et de la jurisprudence. Le marché public est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Ces nouvelles formes de marchés requièrent une ingénierie contractuelle plus fine, mais ouvrent la voie à des partenariats durables et innovants. L’émergence de nouvelles formes contractuelles adaptées aux enjeux environnementaux constitue une autre tendance notable. Les contrats à impact environnemental, inspirés des contrats à impact social, permettent de conditionner la rémunération du titulaire à l’atteinte d’objectifs environnementaux mesurables. Ce type de mécanisme, expérimenté par plusieurs collectivités territoriales, pourrait se développer pour les marchés à fort enjeu écologique. Cette évolution normative s’inscrit dans un mouvement plus large de « verdissement » des politiques publiques, traduisant la volonté des autorités françaises et européennes de mobiliser tous les leviers disponibles pour faire face aux défis environnementaux contemporains. Les trois piliers du développement durable (économie, social, environnement) doivent être appréciés par l’acheteur pour chaque marché public.
La Convention d’Aarhus a quant à elle consacré les droits du public à l’information environnementale, renforçant les obligations de transparence des gestionnaires d’infrastructures. Par exemple, une entreprise de services de propreté mettant en avant sa flotte de véhicules électriques, son système de tri sur site, et ses produits d’entretien éco-labellisés, présentera une valeur environnementale tangible qui pourra justifier une note élevée sur les critères RSE dans l’analyse des offres. La commande publique durable suppose d’arbitrer avec lucidité entre coût immédiat et impact environnemental global. Un produit plus cher à l’achat mais plus économe en énergie, moins polluant ou plus durable peut s’avérer plus performant sur le long terme. Cette logique doit être expliquée, documentée et assumée, aussi bien dans le rapport d’analyse des offres que dans la justification du choix de l’attributaire.
Préoccupations sociales : responsabilité sociale
Il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il aura recours à une telle méthode (CE, 2 août 2011, n° , SIVOA). Le contexte économique tendu, marqué par l’inflation et les restrictions budgétaires, accentue ces difficultés. Les acheteurs publics peuvent être tentés de privilégier le critère prix au détriment des considérations environnementales, malgré les obligations légales. Un rapport de la Cour des comptes publié en 2021 souligne cette tendance et appelle à un changement de paradigme dans l’évaluation de la performance des achats publics. «Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Mécanismes de prévention et obligations procédurales
Les dispositifs ayant comme objectif la prise en compte du développement durable et la protection de l’environnement, ainsi que la responsabilité sociale des acheteurs publics, ont été progressivement intégrés dans le droit des marchés publics français depuis 2004. Quant au sous-sous-critère ” moyens matériels de l’entreprise “, qui ne se limitait pas à une simple présentation de ces moyens mais visait à apprécier leur adaptation au marché, il pouvait également être retenu comme un critère de sélection des offres par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des critères de sélection des offres ne peut qu’être écarté. Un nombre croissant de dispositions encadrent le comportement des personnes publiques afin de limiter l’impact de leurs achats sur l’environnement.
Depuis 2004, le Code des marchés publics a permis d’introduire des considérations environnementales dans les critères d’attribution des marchés publics. Désormais, l’article R du Code de la commande publique prévoit que l’attribution du marché peut se fonder sur des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.La liste des critères envisageables s’est élargie, avec par exemple l’introduction des critères de « biodiversité » et de « bien-être animal ». Les acheteurs disposent de liberté pour fixer des critères liés au développement durable, sans que cela soit une obligation.Néanmoins, ces critères doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique. La prise en compte des préoccupations environnementales dans les marchés publics représente un levier majeur pour la transition écologique. En France, la commande publique pèse près de 200 milliards d’euros par an, soit environ 10% du PIB national. Cette puissance d’achat considérable peut orienter l’économie vers des modes de production et de consommation plus respectueux de l’environnement.
Si l’on s’en tient aux données de Moralscore, c’est La Poste Mobile qui se distingue comme l’opérateur le plus éthique (outre les MVNO engagés cités précédemment). L’opérateur virtuel est aujourd’hui plébiscité pour son engagement environnemental, mais aussi sa transparence, la qualité du service et les conditions de travail. Concernant les opérateurs mobiles, il n’est pas toujours simple de savoir lequel est le plus éthique. L’objectif pour les consommateurs est de pouvoir choisir plus facilement des sociétés qui leur correspondent. Outre les opérateurs engagés pour l’environnement, vous pouvez aussi regarder de plus près les autres firmes présentes sur le marché. Consommer d’une manière plus éthique et responsable est désormais une priorité pour le grand public.
Validité de la notation du critère délai d’exécution par établissement d’une grille de correspondance par intervalles de délais proposés et de notes attribuées, l’application de cette méthode, à tous les candidats respectant en l’espèce l’égalité de traitement (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° , Tables Lebon). CE, 29 octobre 2013,n° , Val d’Oise Habitat (La méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas). CE, 25 mars 2013, n° , Département de l’Isère, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Ce critère ne doit pas être discriminatoire et il doit permettre d’apprécier objectivement ces offres).
A compter du 22 août 2026, les caractéristiques environnementales de l’offre devront obligatoirement être prises en compte par les acheteurs pour l’attribution de leurs marchés publics 1. 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Ainsi, en imposant l’obligation de prendre en compte le développement durable dans Wettigo les spécifications techniques, l’article 35 concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin. La responsabilité environnementale des opérateurs d’infrastructures critiques fait face à des défis émergents qui appellent une adaptation continue du cadre juridique. Le premier de ces défis concerne l’articulation entre impératifs de sécurité et exigences environnementales.
Ils ont ainsi la responsabilité de déterminer le critère qui leur semble le plus approprié en fonction des spécificités du contrat concerné. Cette approche intégrée se traduit enfin par le développement de partenariats innovants entre opérateurs d’infrastructures, autorités publiques, communautés locales et organisations environnementales. Ces collaborations permettent d’identifier des solutions fondées sur la nature, de mutualiser les efforts de recherche et développement, et d’améliorer l’acceptabilité sociale des projets d’infrastructures. Le Pacte vert pour l’Europe encourage explicitement ces démarches partenariales comme leviers de transformation écologique des infrastructures essentielles. Les gestionnaires d’infrastructures énergétiques doivent désormais intégrer une part croissante d’énergies renouvelables, développer des réseaux intelligents et mettre en œuvre des stratégies d’efficacité énergétique.
Leur poids économique en fait un outil incontournable pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU pour 2030. Aujourd’hui les critères d’évaluation des offres dans le cadre des marchés publics suscitent des questionnements quant à la prédominance du critère prix. Actuellement, pour la sélection d’une entreprise, la tendance est de privilégier le critère prix, même dans les secteurs cruciaux comme la santé. La loi Climat et résilienceprévoit qu’au plus tard en 2026, les acheteurs devront fixer dans tous leurs marchés des conditions d’exécution prenant en compte des considérations environnementales.
CE, 16 novembre 2016, n° , Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs). Est illégal un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d’emplois, d’insertion et de formation, sans rapport avec l’objet du contrat ou avec ses conditions d’exécution (CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666). Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Les opérateurs sont directement concernés par la notion de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Comme évoqué précédemment, posséder les meilleures offres n’est plus suffisant pour être le leader du marché de la téléphonie mobile. Il faut désormais assurer un bon rapport qualité/prix, répondre à un réel besoin, mais aussi se développer de manière durable et assurer le bien-être des collaborateurs.